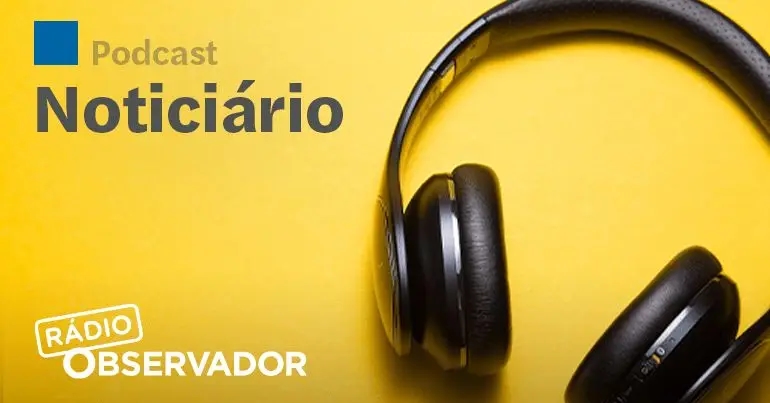Traiter la mémoire de l’émigration : une urgence historique

Le Portugal doit beaucoup à ses émigrants. En plus d'un siècle, des millions de personnes ont quitté le pays, poussées par les difficultés économiques, les persécutions politiques ou le manque d'opportunités. En échange, ils ont envoyé des fonds, créé des réseaux commerciaux, soutenu leurs familles et même contribué à légitimer le pays à l'international en période d'isolement. Pourtant, le souvenir de cette émigration reste oublié. Des milliers de documents témoignent de cette expérience : fiches d’embarquement, autorisations de départ, opinions politiques, rapports consulaires, correspondances d’associations étrangères, images, listes de passagers, dossiers de succession et d’expulsion. Ce sont des fragments d’un vaste patrimoine archivistique qui demeure, pour une large part, non traité, numérisé et indisponible. Nous ne sommes pas confrontés à un problème technique, mais plutôt à un impératif historique. J'ai eu l'occasion de constater cette réalité en tant que conseiller au Secrétariat d'État aux Communautés portugaises. J'ai reconnu le potentiel informatif et scientifique de la documentation existante et j'ai été confronté à l'absence de politique nationale pour son traitement. Parmi les fonds conservés par la Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises – héritière institutionnelle d'organisations telles que le Conseil de l'émigration et l'Institut d'appui à l'émigration – figurent des documents fondamentaux pour la compréhension de la politique migratoire du XXe siècle. Parmi ceux-ci figurent des instructions envoyées aux consulats et des procès-verbaux d'organes délibérants, ainsi que des rapports sur l'émigration clandestine et des avis sur des accords bilatéraux. Dans d’autres archives publiques tout aussi pertinentes, on trouve des vestiges relatifs à la correspondance des communautés portugaises aux États-Unis et au Brésil, des campagnes de propagande de l’Estado Novo auprès de la diaspora, des photographies de départs et d’arrivées, des rapports de voyages maritimes et des documents relatifs à la colonisation des territoires africains. Même les archives de l'ancienne police politique, aujourd'hui conservées à la Torre do Tombo, contiennent des sources essentielles sur le contrôle exercé sur les mouvements frontaliers et les communautés à l'étranger. Il en va de même pour d'autres documents moins explorés, tels que les registres de succession des émigrants décédés au Brésil ou en Inde, ou les documents ferroviaires et syndicaux relatifs au transit de la main-d'œuvre dans la région ibérique. Tout cela montre que la mémoire de l’émigration portugaise ne se trouve pas à un seul endroit : elle est dispersée, fragmentée et vulnérable. Cette réalité exige exactement le contraire de la négligence : elle exige une politique coordonnée, avec des critères techniques partagés, une planification stratégique et une responsabilité institutionnelle. L’archivage et le traitement numérique de cette documentation ne peuvent être laissés au hasard ni à la seule bonne volonté de services surchargés. Un réseau national de coopération doit être créé entre les organismes détenant la documentation, notamment la DGACCP, les archives historiques centrales, l'Observatoire des migrations et les centres de documentation spécialisés. Mais, par-dessus tout, la participation d'une université publique indépendante possédant une expérience avérée dans les domaines de l'histoire et des sciences sociales est essentielle. Sans un suivi académique rigoureux, il existe un risque de gaspillage d'informations, d'application de critères erratiques ou de transformation d'une tâche scientifique en une opération bureaucratique. L'université doit garantir la qualité du traitement, former les chercheurs et superviser l'ensemble du processus avec l'impartialité requise par le sujet. Ce travail technique doit à son tour s'accompagner d'une stratégie de diffusion publique. Les résultats devraient être partagés par le biais d'expositions, de plateformes numériques, de publications et de programmes éducatifs, en collaboration avec des institutions telles que le Musée de l'Émigration de Fafe ou le Musée de l'Émigration des Açores. La mémoire n'a de valeur que si elle est accessible et peut être transmise aux générations futures. Enfin, cet effort doit être pris en compte au plus haut niveau politique. La présidence de la République joue ici un rôle crucial. L'exemple donné par Cavaco Silva, en impliquant directement le conseil consultatif dans ce domaine, doit être réexaminé. Non pas comme une rhétorique circonstancielle, mais comme un engagement institutionnel envers l'un des phénomènes structurants de notre histoire contemporaine.
Traiter, numériser et rendre publique la documentation sur l'émigration portugaise est plus qu'une simple tâche d'archivage. C'est un acte de justice historique. C'est la manière la plus solide et la plus digne de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés et de construire, à partir de leur mémoire, une compréhension plus complète de qui nous sommes.
observador