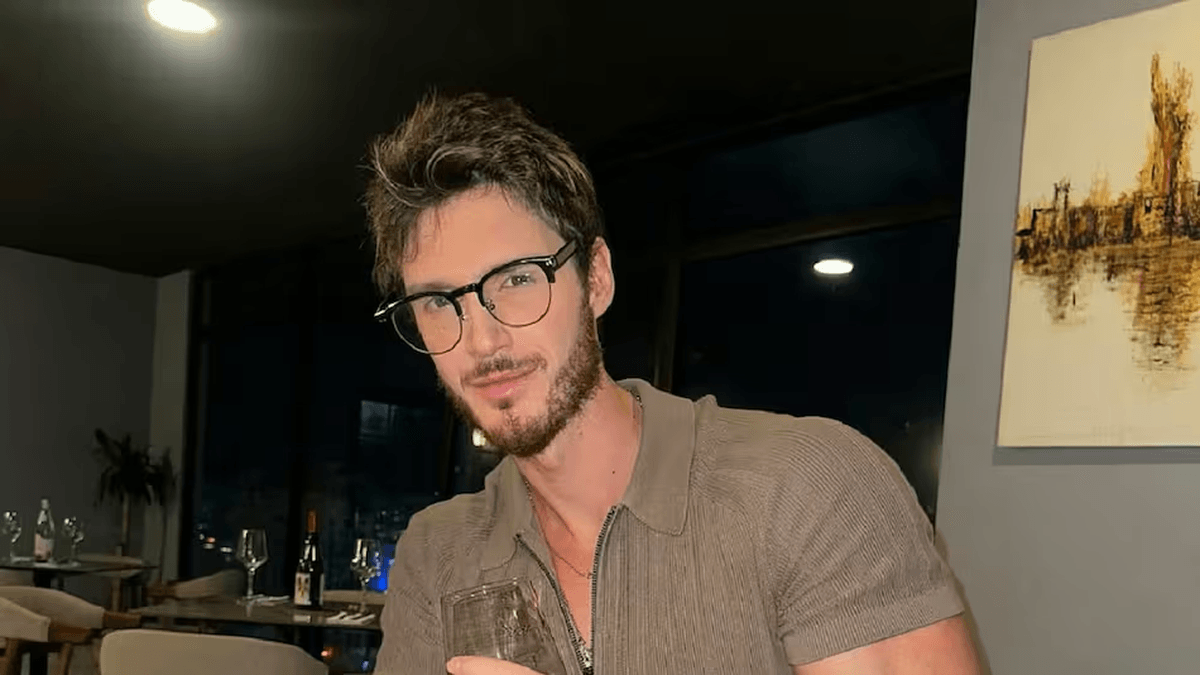Le « rêve américain » de Miró : « En Espagne, il a été marqué par les limitations et la répression ; aux États-Unis, il a trouvé un espace de liberté et de créativité. »

Miró n'aurait pas été Miró sans Paris. Sa géographie intime commence à Barcelone, où il est né en 1893, et se poursuit sur son île de Majorque, où il peignait déjà des paysages exquis à l'adolescence. Elle s'étend également à la campagne tarragonaise, qui le fascinait par ses paysages secrets (comme le jeune Picasso, d'ailleurs) et où il peindra la toile emblématique La Masia (1921-1922), dont Ernest Hemingway tomba amoureux et qu'il acheta à crédit, directement auprès de l'artiste (« Tout ce que j'ai aimé en Espagne », disait l'écrivain, vibrait dans ce tableau). Jusqu'à présent, l'anecdote d'Hemingway était l' anecdote américaine la plus populaire sur Joan Miró. Mais Miró n'aurait pas été Miró sans les États-Unis, sans l'impact qu'il a eu outre-Atlantique alors que l'Espagne était sous le joug d'une dictature ; sans les échanges avec d'autres artistes, de Jackson Pollock à Mark Rothko ; sans les grandes sculptures dans les rues de Houston et de Chicago, plus grandes que celles que nous avons en Espagne.
« Dans les années 1940, marquées par les restrictions et la répression, Miró a trouvé aux États-Unis un espace de liberté et de créativité. Il a noué des relations avec des artistes américains avec lesquels il partageait une vision expérimentale de l'art, tissant ainsi une carte de complicités qui a contribué à inscrire l'œuvre de Miró dans un contexte mondial », explique Marko Daniel, directeur de la Fondation Miró à Barcelone, qui révèle cette relation inédite dans la grande exposition anthologique Miró et les États-Unis , coproduite avec la Phillips Collection de Washington, où elle sera présentée au printemps 2026. Parrainée par la Fondation BBVA (qui compte déjà 36 ans de mécénat et siège même au conseil d'administration du musée), cette exposition-thèse présente 138 œuvres de 49 artistes, dont Miró lui-même, bien sûr, confrontant les créateurs qui ont forgé l'art moderne.

« Il convient de noter que la conversation était artistique, car Miró n'a jamais appris l'anglais. L'implication de ses échanges avec d'autres artistes était donc très pure », note Matthew Gale , directeur de la Phillips Collection et commissaire de l'exposition. « Miró a traversé l'Atlantique à sept reprises. Ces voyages ont constitué la base de nos recherches. La première fois, c'était en 1947, et il y a trouvé un contexte artistique où il était admiré et compris, contrastant avec le relatif isolement qu'il connaissait en Espagne », ajoute-t-il.
En plus de raconter une histoire inédite, sur laquelle très peu de recherches ont été faites, l'exposition présente deux grands atouts : la possibilité de voir des tableaux de Pollock, Rothko ou Krasner en Espagne et de voir certains Miró revenir chez eux après plusieurs décennies en Amérique avec des prêts exceptionnels du MoMA (qui prête, entre autres, le précieux Personnage jetant une pierre sur un oiseau (1926), la première œuvre qu'il a acquise du peintre en 1937 et qui ne quitte généralement pas le musée), de Harvard (avec son exquise Peinture murale de 1964, une frise de près de 3,6 mètres ), du Musée de Philadelphie et de plusieurs collections privées.
L'exposition s'ouvre avec les deux premières œuvres de Miró vues aux États-Unis, dans le cadre de l' Exposition internationale d'art moderne de 1926 organisée au Brooklyn Museum par Marcel Duchamp lui-même et la brillante Katherine S. Dreier, peintre et collectionneuse : Le renversement (1924), une toile surréaliste aux tons ocres, et Pintura (1926), un bleu pur et spirituel.
Dès l'entrée dans l'exposition, le visiteur peut ressentir un léger choc , accentué par l'architecture de la Fondation Miró, conçue par son grand ami, l'architecte Josep Lluís Sert, celui-là même qui accueillit Miró et son épouse Pilar Juncosa à leur arrivée aux États-Unis en 1947. Sert, qui deviendra plus tard doyen de Harvard, était déjà en exil depuis des années. Il fut l'auteur du Pavillon de la République de 1937 à l'Exposition internationale de Paris, où Picasso exposa Guernica et Miró la grande fresque murale Els Segadors, aujourd'hui disparue. Pour concevoir sa Fondation, Sert s'inspira de l'architecture méditerranéenne traditionnelle, avec ses murs blanchis à la chaux et ses sols en céramique, et lui inspira des lignes modernes, avec des points de fuite et des angles audacieux, spécialement conçus pour l'œuvre de Miró. Cet espace fait que, dès que le visiteur entre, il perçoit en une seule seconde des dizaines d'œuvres (et quelles œuvres !) : les totems blancs de Louise Bourgeois, le vert puissant de Miró de Message from a Friend (une toile de presque trois mètres que prête la Tate de Londres), les sculptures noires - debout et suspendues - d' Alexander Calder et, presque à l'horizon, au fond, une abstraction spectaculaire aux tons roses et verts qui s'avère être un tableau de plus de cinq mètres de Lee Krasner, The Seasons (1957), que le Whitney de New York prête dans un geste inhabituel, puisqu'il s'agit d'un de ses magnum opus (l'artiste l'a peint juste après la mort de Pollock, son mari, dans un accident de voiture mortel).
Chaque mur, chaque coin, recèle son propre contraste. Ou fusion. Car ce jaune de Miró se marie si bien avec l'orange liquide d' Helen Frankenthaler et le rouge coupé de bleu de Rothko.
L'un des rêves de Miró était d'accueillir chaque voyageur arrivant à Barcelone par voie terrestre, aérienne ou maritime. Il le fait à l'aéroport, avec sa magnifique fresque murale au Terminal 2 (il est prévu de la déplacer au Terminal 1), et sur La Rambla, avec son sol en mosaïque circulaire, foulé par les passagers débarquant par voie maritime (les habitudes des croisiéristes du XXIe siècle ont changé). Le terrain lui manquait. Miró projeta une grande sculpture à l'entrée de la Diagonal, dans le parc Cervantès (surnommé par les Barcelonais le Parc des Roses) : Le Soleil, la Lune et une Étoile . La maquette de 1968 est visible dans le patio nord de la Fondation Miró, avec la skyline de Barcelone en arrière-plan. Mais la sculpture, haute de plus de 12 mètres, vit le jour en 1981 au cœur de la Brunswick Plaza, au milieu des gratte-ciel de Chicago. Les Barcelonais la surnomment communément Miss Chicago . Et Miró vit son rêve américain se réaliser.
elmundo