Le retrait des États-Unis, une chance pour la COP30 ?
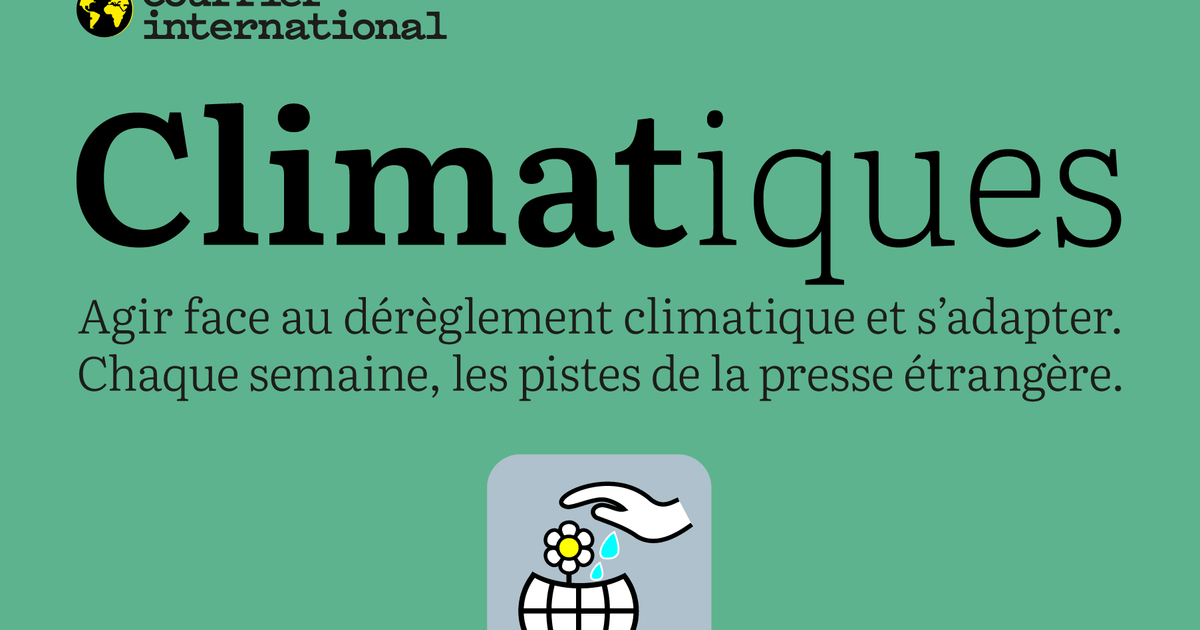
Ça chauffe ! À cinq jours de l’ouverture de la COP30, la 30e Conférence des parties sur les changements climatiques, à Belém, au Brésil, l’alerte est lancée. Les États-Unis de Trump incarnent l’éléphant sorti de la pièce, le pays s’étant une deuxième fois retiré des discussions internationales sur le sujet. Mais les pays de l’Union européenne, qui sont parvenus à la toute dernière minute (après une nuit de négociations difficiles) à se mettre d’accord a minima sur une feuille de route, ne sont pas non plus en position de donner des leçons.
D’ailleurs, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) dans l’état des lieux qu’il vient de dresser, comme chaque année, pour poser les enjeux des négociations à venir, fait une sorte de rappel à l’ordre. Si les politiques actuelles se poursuivent, la planète se réchauffera de 2,8 °C par rapport aux niveaux préindustriels – soit bien plus que l’objectif de 1,5 °C ou, au maximum, 2 °C que s’est fixé la communauté internationale en signant l’accord de Paris il y a dix ans. Et si tous les engagements égrenés au fil des derniers mois par les États sont respectés, le réchauffement pourrait être limité à une fourchette comprise entre 2,3 °C et 2,5 °C.
Ce serait, disons, un peu moins mauvais. Mais on serait encore bien loin du compte. D’autant que les calculs du PNUE ne prennent pas en considération les conséquences du retrait des États-Unis de l’accord de Paris, en janvier prochain. Ce pays, qui est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre (GES) de la planète, n’enverra aucun représentant de haut niveau à Belém. Et, paradoxalement, c’est ce qui constitue aujourd’hui le plus grand motif d’optimisme.
“Sans les États-Unis, le reste du monde aura peut-être l’occasion de parvenir à un consensus à Belém”, estime Claudio Angelo, de l’Observatório do Clima, plus grand réseau d’organisations de défense du climat à Brasília, interrogé par Nature.
Car d’autres nations semblent prêtes à s’affirmer sur la scène climatique. La Chine, tout d’abord. Certes, elle est la première émettrice de GES, mais elle “joue également un rôle moteur à l’échelle mondiale en ce qui concerne l’adoption des énergies propres et la production des équipements nécessaires à la transition vers une économie décarbonée – panneaux solaires, éoliennes et véhicules électriques”, ajoute l’hebdomadaire britannique.
Surtout, Pékin a annoncé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de GES – une déclaration d’autant plus solennelle qu’elle a été faite par le président Xi Jinping en personne. “La Chine pourrait jouer un rôle de premier plan lors de la COP30 en usant de son influence auprès des pays en développement pour faciliter les négociations avec les pays développés”, poursuit Nature.
Et puis il y a le Brésil de Lula da Silva, pays particulièrement affecté par les effets du dérèglement climatique et qui, en tant qu’hôte de la COP30, est censé mettre de l’huile dans les négociations. Un rôle que ce pays joue déjà depuis des mois au sein des Brics+, ce bloc de pays auquel appartient également la Chine et dont il assure actuellement la présidence, plaçant systématiquement la question climatique à l’ordre du jour de tous les sommets.
Aujourd’hui, tous les espoirs reposent donc sur le Sud global, comme l’explique cette semaine la une de Courrier international, titrée “Xi Jinping et Lula au secours du climat”.
Pascale Boyen
Vous n’êtes pas encore abonné ? Abonnez-vous dès 1€La “chanson douce” des combustibles fossiles
Le secrétaire général de l’Opep, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, s’est réjoui cette semaine du “‘grand changement’ dans la façon dont les industriels et les décideurs politiques parlent désormais de la nécessité de répondre à la demande mondiale croissante d’énergie”, rapporte CNBC. Pour Haitham Al-Ghais, cette nouvelle tonalité a “un air de chanson douce”. Comme lui, les acteurs du secteur réunis pour leur grand rendez-vous annuel à Abou Dhabi défendent l’idée que les combustibles fossiles s’additionnent aux énergies renouvelables plutôt qu’ils ne cèdent la place à l’éolien et au solaire. Pour en savoir plus, c’est ici.
Éoliennes en mer face aux vents extrêmes
D’après une étude parue dans Nature Communications le 4 novembre, plus de 40 % des plateformes éoliennes en mers d’Asie et d’Europe sont situées dans des zones où les vents dépassent la vitesse maximale de 135 km/h que peuvent supporter certaines turbines. À cause du changement climatique, la vitesse des vents a augmenté et les événements météorologiques extrêmes, comme les cyclones, sont de plus en plus fréquents. Pour en savoir plus, c’est ici.
Des industriels allemands devant la justice
En mars, à l’occasion d’un procès (perdu) par un paysan péruvien, la justice allemande avait considéré qu’il était possible de condamner une entreprise pour sa responsabilité dans le dérèglement climatique, y compris si les conséquences sont observées à l’autre bout du monde. Quelques mois plus tard, ce sont 43 paysans pakistanais qui ont saisi la justice contre l’énergéticien RWE et le producteur de ciment Heidelberg Materials. “Ils appellent les deux entreprises à les dédommager pour les pertes et dommages qu’ils affirment avoir subi il y a près de trois ans, à l’occasion d’importantes inondations”, indique la Westdeutscher Rundfunk (WDR). Pour en savoir plus, c’est ici.
Vous venez de lire l’édition numéro 117 de Climatiques.
Courrier International





